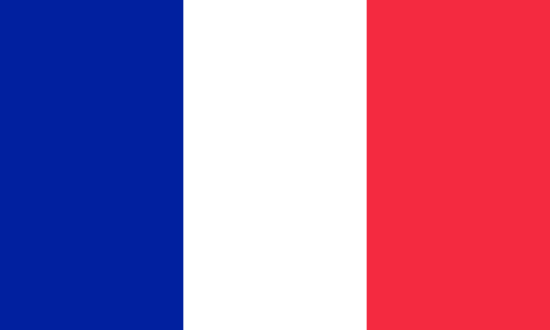
France
Casque Modèle 33 motocycliste
Fiche
- Dénomination: Casque protecteur pour motocycliste.
- Destiné à la Gendarmerie Nationale.
- Caractéristiques: 3 types successifs entre 1933 et 1941.
- Coiffe en toile (types 1 et 2), puis en cuir (type 3).
- Jugulaire: Incorporée dans l'ensemble bavolets-nuquière en cuir.
- Attribut: maintenu par agrafes crampons dans 2 fentes frontales.
- Fabriqué à partir de 1933.
- Distribué à partir de 1933.
- Pays d'origine : France.
- Période d'utilisation : de 1933 jusqu'aux années 50.
- Matériau : Aluminium embouti.
- Poids : De 700g à 1kg suivant les tailles et les types.
- Tailles : Trois tailles de bombe contenant les pointures de 54 à 62.
- Couleur : Bleu nuit.

1er type.

2ème type.

3ème type.
Historique
|
La Gendarmerie est chargée de la surveillance de la circulation depuis fort longtemps. La loi de germinal an VI l'évoque déjà, puis la loi du 30 mai 1851 et son décret organique de 1903. |
 Gendarmes motocyclistes en képi. |
Il s'agit, tel que décrit au BO du 1er novembre 1933, d'un casque dont la bombe en aluminium comporte un rembourrage en liège et caoutchouc mousse, le tout complété par une visière et un couvre nuque garnis de cuir, une coiffe en cretonne et des bavolets de cuir. L'attribut est la grenade en maillechort nickelé.
En 1934, des motocyclistes de la Garde Républicaine Mobile de SATORY (78), sont entraînés et forment la première escorte présidentielle. Le port du casque protecteur pour motocycliste est étendu à la Garde Républicaine Mobile en mars 1937, (BO du 15/12/1936), puis à la Garde Républicaine de Paris (BO du 8/3/1937). Pour ces deux corps, l'attribut est identique, mais la grenade est en laiton doré.
Un certain nombre de casques protecteurs est utilisé par le ministère de l'Intérieur de Vichy, tant pour les motocyclistes de la police que ceux des GMR.
Enfin le BO du 3/11/1942 attribut ce casque aux motocyclistes de la garde personnelle du chef de l’État Français, le maréchal Pétain (dissoute en 1945).
Deux versions améliorées, comportant des renforts latéraux et des déflecteurs d'oreillère, font leur apparition en 1941. La deuxième est munie d'une coiffe en cuir à six dents.
Après la guerre, le Casque protecteur pour motocycliste, toutes versions confondues, continuera sa carrière notamment au sein des BMO (brigades motorisées) et des escortes officielles. Il sera remplacé dans les années 50 par le fameux "casque bol".
La bombe en alu de ce casque sera à la base du casque radio-char type 1935, du casque d'entrainement TAP mle 45 et de très nombreux casques civils.







Constitution
1er type.
Le casque protecteur pour motocycliste se compose d'une bombe, d'une coiffe, de deux bavolets, d'une visière et d'un couvre-nuque.
La bombe.
 Vue avant. |
 Vue de coté. |
 Vue de dessus. |
 Vue arrière. |
 Cette épave permet d'appréhender la forme de la bombe brute. Vue de coté. |
 Vue arrière. |
 Garniture intérieure. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La bombe est confectionnée d'une seule pièce, en aluminium d'une épaisseur de 16/10èmes de mm. Elle affecte la forme d'une demi-sphère surhaussée et ovalisée à sa base. Le bord de la bombe est légèrement retourné vers l'extérieur.
Sur tout le pourtour de la bombe, à 22 mm de sa base, est embouti un jonc de 7 mm de largeur. Au dessous de ce jonc, une série de trous de 3 mm de diamètre, espacés de 20 mm, sont percés à 7 mm de la base. Ils permettront le montage de la coiffe, des bavolets de la visière et du couvre-nuque.
L'insigne du casque doit être fixé devant la bombe. A cet effet deux entailles permettant le passage des deux branches de l'agrafe-crampon sont pratiquées sur le devant de la bombe. L'entaille inférieure est à 35 mm de la base de la bombe.
La bombe comporte en outre, deux trous d'aération de 4 mm à l'avant et deux autres identiques à l'arrière. Ils sont espacés de 55 mm et placés respectivement, à 105 mm, 110mm et 115 mm du bas, selon les tailles: I, II et III.
La bombe est passée au vernis gras de couleur bleu gendarme et séchée en étuve; entre 125 et 140°, pendant une durée minima de 1h30. Il faut que le vernis extérieur ne puisse s'écailler à la pression et qu'il soit en état de supporter sans se ramollir le contact de l'eau chaude à 75°.
Une garniture intérieure est collée dans la bombe. Elle se compose:
-d'une feuille de liège aggloméré, d'une épaisseur minimum de 2 mm, divisée en 4 quartiers égaux qui se joignent au sommet de la bombe et qui épousent exactement sa forme.
-d'une feuille de caoutchouc mousse d'une épaisseur minimum de 5 mm, divisés également en 4 quartiers égaux, collés entre eux et au liège avec de la dissolution de caoutchouc.
-d'un tissu de protection en poltaise kaki foncé (132g/m2), collé sur le caoutchouc mousse.
Les trous d'aération sont prolongés à travers les 3 couches.
La bombe est fabriquée en 3 tailles désignées: I, II et III, dont les dimensions sont données dans le tableau qui précède. Ces tailles correspondent, avec la garniture décrite, aux pointures 56,59 et 62. Les pointures intermédiaires, de 54 à 61 sont obtenues en augmentant de façon adaptée, les épaisseurs de la feuille de liège et du caoutchouc mousse, des casques de pointures 54, 55, 57, 58, 60 et 61.
La coiffe.
 Vue d'ensemble. |
 Coiffe développée. |
 Vue de la couture oblique. |
La coiffe proprement dite est formée par un cylindre de cretonne écrue. La hauteur apparente de la coiffe est, respectivement, de 110mm, 120 mm et 130 mm, pour les tailles I, II et III.
Elle présente à son sommet un rempli en ourlet de 10mm dans lequel coulisse un une ganse de soie genre tresse (185g/m2), destinée à resserrer la coiffe en cette partie.
Le manchon est fermé par une couture oblique. On remarque que la trame de la toile subit la même inclinaison. Ceci est du au procédé de confection industriel. La toile est livrée en bandes de très grande longueur et de 50cm de large. Elle est ensuite enroulée en spirale plus ou moins serrée suivant le diamètre de manchon à obtenir. Une couture ouverte est réalisée sur toute la longueur, on obtient ainsi un long tube de tissu, qu'il suffit de débiter en tronçons de 130 mm, 140 mm et 150mm. On obtient finalement des cylindres à couture oblique, qui après ourlage et couture formeront des manchons de 110 mm, 120 mm et 130 mm. Ce procédé évite la perte de tissu, car il n'y a pratiquement aucune chute de découpage.
Les bavolets.
 Bavolet droit. |
 Intérieur du bavolet droit. |
 Jonction arrière des bavolets. |
 Vue d'ensemble du bavolet gauche. |
Les bavolets sont formés de deux morceaux égaux de cuir de mouton chromé, noirci, de 7/10èmes à 1 mm d'épaisseur, réunis à l'arrière par une couture à la machine. |
 Ces vues de profil et de biais, permettent de visualiser l'empilement des différentes pièces de l'oreillère.
|
 Vue du bourrelet de la rondelle extérieure. |
 Vue du bourrelet de la rondelle intérieure. |
 Vue de la cuvette et du mica, la petite rondelle étant déposée. |
|
Afin de percevoir l'ambiance extérieure, dans chacune des oreillères est pratiquée une ouverture circulaire de 27 mm (environ) de diamètre, dans laquelle est logée une plaque de mica circulaire enchâssée entre deux rondelles de caoutchouc moulé. |
 Vue en coupe d'un bavolet, au niveau d'un diamètre du dispositif acoustique. |
Cet ensemble est positionné au niveau de l'ouverture circulaire du bavolet, la rondelle principale vers l'extérieur. Le tout est maintenu par une couronne de mouton chromé noirci, de 27 mm de diamètre intérieur et de 80 mm de diamètre extérieur, formant dôme. Employée fleur apparente cette couronne est fixée à plat par une piqure, à ras de la rondelle. Cette couture circulaire fait environ 70 mm de diamètre, et prend aussi la doublure en cretonne, de façon que l'ouverture de 27 mm de diamètre, qui y est pratiquée, reste alignée avec les autres.
 Base du bavolet gauche avec sa jugulaire et celle du bavolet droit avec sa boucle.
|
 |
 Jugulaire fermée. |
A l'oreillère gauche, entre la doublure et le dessus en mouton, est fixée par une couture triangulaire à la machine, une bande de mouton de même nature que les bavolets, d'une longueur apparente de 210 mm et d'une largeur apparente de 25 mm, repliée sur elle même et piquée à cordon sur ses bords latéraux à 2mm environ de ceux ci et se terminant à bords ouverts (A noter que dans l'immense majorité des cas, cette extrémité voit ses angles abattus et cousus pour former une pointe).
Cette bande qui forme jugulaire, est munie de huit œillets en cuivre verni noir, distants les uns des autres de 10 mm, le 1er étant situé à 25 mm de l'extrémité libre.
Entre la doublure et le dessus de l'oreillère droite, à 15 mm de son extrémité, est fixé un passant en mouton chromé et noirci. Immédiatement au dessus de ce passant, une boucle à rouleau à un ardillon en fer nickelé ainsi qu'un second passant, sont maintenus par une enchapure cousue sur l'oreillère. La boucle à rouleau a une largeur de 23 mm et une hauteur de 14 mm. Les passants d'une largeur apparente de 7 mm, de même que l'enchapure d'une largeur apparente de 23 mm, sont formés d'une bande de mouton, de même nature que celui déjà utilisé et confectionnés de même façon que la bande de l'oreillère gauche, formant jugulaire.
La visière et lecouvre-nuque.
 Visière, dessus et dessous. |
 Couvre-nuque, dessus et dessous. |
La visière et le couvre-nuque sont formés respectivement d'un carton carte, de 2mm d'épaisseur, découpé en forme ogivale et recouvert, dessus et dessous, par 2 morceaux de mouton chromé et noirci de 7/10 èmes à 1 mm d'épaisseur.
Ces 2 morceaux de cuir, employés fleur apparente, sont réunis fleur sur fleur par une couture à la machine, retournée et située au dessous et aux bords extérieurs de la visière et du couvre nuque. Leurs parties libres, qui dépassent les bords intérieur du carton-carte, forment gorge, permettant la fixation de la visière et du couvre nuque à la bombe en utilisant les trous pratiqués sur le pourtour de cette dernière.
Le bourdalou.
 Couture périphérique. |
 Bordalou et passant pour lunettes. |
La garniture intérieure, la coiffe, les bavolets, la visière et le couvre-nuque sont fixés très solidement à la bombe par une couture utilisant les trous pratiqués sur le pourtour et à la base de celle ci. Le bord de la coiffe est pris sous la feuille de liège. Le fil employé est un fil de lin kaki foncé, métrage français n°30 (0,588mm).
Un bourdalou d'une largeur de 16 mm, également en cuir de mouton chromé et noirci, de 7/10è à 1 mm d'épaisseur, recouvre, à l'extérieur de la bombe et au dessous du jonc existant à sa base, les points de couture nécessités par le montage. Il est muni de deux passants fixés de chaque côté du casque à la hauteur des oreillères. Ces passants sont de même nature et confectionnés de la même façon que ceux des bavolets.
2ème type.
Vers 1940-41, vraisemblablement à l'occasion d'une commande de réassortiment, quelques améliorations sont apportées au casque de protection motocycliste. Pour faciliter la compréhension, nous désignerons 2ème type, cette version améliorée, non décrite au BO. Seuls les éléments modifiés seront repris dans la description qui suit.
La bombe.
 Volet d'accès aux agrafes de l'attribut. |
 Volet ouvert. |
La bombe est totalement inchangée. Seule une incision en V est pratiquée dans la garniture, au niveau des fentes d'attribut. Elle permet de définir un volet triangulaire rabattable, facilitant l'insertion et le rabattement des agrafes-crampons de l'attribut.
La coiffe.
 Vue d'ensemble. |
 Bandes de renfort sommital. |
La coiffe est toujours formée par un cylindre de cretonne écrue de dimensions inchangées. Elle est par contre renforcée par trois bandes de forte toile, genre webbing, de 50 mm de largeur, disposées entre elles et la garniture de la bombe. Ces bandes sont fixées par la couture périphérique comme le reste du montage. Elles se croisent au sommet de la bombe.
Les bavolets.
 Gros plan sur le déflecteur et le passant gauches. |
 Bavolet droit. |
 Intérieur du bavolet. |
|
L'ensemble bavolets jugulaire reste identique. L'amélioration est faite au niveau des oreillères. La feuille de mica est supprimée, ainsi que les rondelles de caoutchouc et de cuir. Elle est remplacée par un déflecteur de cuir en mouton chromé et noirci. Il s'agit d'un triangle isocèle dont le sommet est arrondi. Il est cousu sur le bavolet, sommet vers l'avant, de façon à former un demi-cône au dessus du trou de l'oreillère. La couture est renforcée par deux rivets placés, de part et d'autre, à l'arrière du déflecteur. |
 2 types de boucles coexistent. |

Vue du rembourrage sur un exemplaire détérioré.
Le bourdalou.
 Bourdalou, côté gauche. |
 Rivet de maintien du bourrelet. |
 Couture entre la lanière et le bourrelet. |
 La même couture vue de profil. |
Le bourdalou est augmenté de deux bourrelets de protection latéraux, placés aux dessus des oreillères. Ces bourrelets sont recouverts de mouton chromé et noirci. Ils sont fixés au casque par un rivet médian dont la tête est noyée dans l'épaisseur du rembourrage. D'une longueur de 17 à 18 cm, ils ont une largeur de 3 cm au centre. Les extrémités ont la même largeur que le boudalou.
Le bourdalou proprement dit est constitué de deux lanières de 16 mm du même cuir, reliant les bourrelets entre eux à l'avant et à l'arrière. Ces lanières sont cousues aux extrémités des bourrelets.
3ème type.
En 1941, apparaît encore une amélioration non décrite au BO. Ce casque est souvent appelé mle 33/41 par les collectionneurs, dans un souci de clarté nous le désignerons: 3ème type.
Seuls les éléments modifiés par rapport au 2ème type, seront repris dans la description qui suit.
La bombe.
 Garniture intérieure. |
 Volet d'accès aux agrafes de l'attribut. |
 Volet ouvert. |
La bombe ne présente aucune modification, elle comporte toujours, dans sa garniture, le volet relevable donnant accès à l'agrafe de l'attribut.
La coiffe.
 Vue d'ensemble. |
 Bandes de renfort en toile de jute. |
 Vue d'ensemble du montage de la coiffe. |
 Avers d'une dent. |
 Envers d'une dent. |
 Le bord du bandeau est pris dans la couture périphérique. |
La coiffe en cretonne des types précédents est complètement abandonnée et remplacée par une classique coiffe en cuir à 6 dents. |
Les bavolets.
 Bavolet droit. |
 Doublure en basane. |
 Gros plan sur le déflecteur et le passant. |
 Jonction arrière des bavolets. |
 Vue arrière d'un déflecteur. |
 L'intérieur des déflecteurs est doublé d'une grosse toile. |
L'ensemble bavolets jugulaire reste identique extérieurement, à celui du 2ème type. Intérieurement la doublure en cretonne est remplacée par une basane de cuir brun disposée dans les mêmes conditions. En outre, l'intérieur des déflecteurs des oreillères est doublé d'une grosse toile destinée à le raidir.
Le bourdalou.
 Vue d'ensemble du bourdalou et du bourrelet gauches. |
 Détail de la tête de rivet. |
 Le bourdalou passe sous le bourrelet droit. |
 Le bourrelet gauche masque les extrémités non jointives du bourdalou. |
Le bourdalou comporte toujours les deux bourrelets de protection latéraux, de dimensions identiques, mais le montage est quelque peu différent.
Le bourdalou proprement dit est constitué par une seule lanière de mouton de 16 mm, comme sur le 1er type. Ses extrémités, se situent sur le milieu du coté gauche, cependant elles ne sont pas jointives, ce qui permet d'avoir une seule taille de bourdalou pour les trois tailles de coque.
Les bourrelets latéraux font office de fixation du bourdalou. En effet, ils sont fixés au casque par un rivet médian dont la tête est noyée dans l'épaisseur du rembourrage comme sur le type 2, mais ils sont rivés à chaque extrémité et non plus cousus. Ces six rivets traversent le bourdalou et le maintiennent en place. Le bourrelet gauche masque les extrémités non jointives.
Les attributs.
 Gendarmerie Départementale. |
 Garde Républicaine, Garde Républicaine Mobile. |
 Police de Vichy. |
 Garde du Maréchal. |
Primitivement ce casque est destiné à la Gendarmerie Départementale. Le 19 juillet 1933, le bureau technique de la direction de la Gendarmerie fait obligation aux personnels conducteurs de motocyclettes, d'êtres coiffés du nouveau casque réglementaire.
L'insigne décrit au BO, le 1/11/1933, est donc celui de la Gendarmerie Départementale.
Il est constitué par une grenade en maillechort nickelé de même forme et dimensions que celle du casque du modèle général. Il est fixé au casque par une agrafe-crampon formée d'une bande de fer blanc, de 4/10è de mm d'épaisseur, de 5 mm de largeur et de 75 mm de longueur. Cette agrafe est soudée sur l'insigne sur une longueur de 35 mmn, laissant libres deux branches de 20 mm de longueur chacune. Ces branches libres pénètrent dans les entailles prévues à cet effet et sont rabattues à l'intérieur de la bombe, sous la feuille de liège de façon à assurer l'adhérence de l'insigne.
Le port du casque protecteur pour motocycliste est étendu à la Garde Républicaine Mobile (BO du 15/12/1936), puis à la Garde Républicaine de Paris (BO du 8/3/1937). Pour ces deux corps, l'attribut est identique, mais la grenade est en laiton doré.
Un certain nombre de casques protecteurs est utilisé par le Ministère de l'Intérieur de Vichy, tant pour les motocyclistes de la police que ceux des GMR. Ils sont parfois repeints en noir. L'attribut porté est le faisceau de licteur argent surmonté d'une francisque, brochant un écu tricolore.
Enfin le BO du 3/11/42 attribut ce casque à l'escorte du maréchal Pétain, bien que ces motocyclistes fassent partie de la Garde du Maréchal, équipée de casques motorisés mle 35. Ces casques sont repeints en noir. L'attribut est celui de la garde du chef de l'état: Une francisque tricolore dont le manche est un bâton de maréchal, brochant une grenade argentée estampée des lettres EF (Etat Français).
Fabricant et marquages.
 Fabricant sur un 1er type. |
 Taille sur un 1er type. |
 Fabricant daté sur un 1er type. |
 Marquage d'un coupon de tissu. |
 Fabricant sur un 2ème type. |
 Réception sur un 2ème type. |
 Taille sur un 3ème type. |
 Etiquette d'atelier sur un 3ème type. |
Les casques de protection pour motocyclistes sont fabriqués par la société GUENEAU. On retrouve leur marque sous forme de tampon linéaire dans les fabrications précoces puis de tampon rond à date par la suite. Dans les casques du 2ème type apparaît un tampon bilinéaire. Aucun marquage fabricant n'a été trouvé dans les casques du 3ème type.
La taille est indiquée sur la coiffe par un simple tampon noir (blanc sur les coiffes du 3ème type).
Un tampon de réception est très rarement apposé.
Exemples.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |